"Mettre des bornes à la concurrence : les prix minimums d’entrée"
vendredi 10 octobre 2025
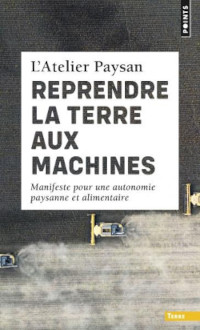
Le texte qui suit est issu de notre manifeste Reprendre la terre aux machines (Seuil, 2021), dans le chapitre 5 dédié aux points d’appui « contre l’impuissance ». Un ouvrage à retrouver en poche aux éditions Points (avril 2023)
Nous publions ce passage de notre manifeste car tout, dans les contextes national, européen et international, vient confirmer l’urgence qu’il y a à sortir des logiques de mise en concurrence permanente entre producteurs et productrices. Cela est le cas à l’échelle de l’accord Union-Européenne/Mercosur qui va fragiliser un peu plus l’agriculture européenne, mais aussi à l’échelle intra-européenne – à condition de le faire dans une logique de protectionnisme solidaire, loin des replis xénophobes que le libre-échange européen encourage justement.
.
Mettre des bornes à la concurrence : les prix minimums d’entrée
Nous avons dit à plusieurs reprises le rôle capital des traités de libre-échange et notamment le traité de Lisbonne, dans l’organisation et la stimulation de la course aux plus bas coûts de production. Le mouvement pour l’agriculture paysanne, comme l’ensemble de la gauche économiquement « antilibérale », a toujours pris des positions critiques envers les grands accords tels que le GATT, l’AMI, le Tafta et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en tant que pilote de ces processus167. Par contre, en dehors de l’épisode de la campagne référendaire sur le Traité constitutionnel européen de 2005, les accords européens restent généralement à l’abri de nos flèches. La crainte d’être assimilés au souverainisme de droite ou d’extrême droite est telle que nous nous empêchons de prendre la mesure du potentiel régressif inscrit dans le marbre des traités continentaux.
Répétons-le : rester soumis au traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), signé par Nicolas Sarkozy méprisant le résultat du référendum de mai 2005, garantit la poursuite de la régression sociale et écologique, en agriculture comme ailleurs. Il interdit en effet toute politique d’harmonisation entre les pays, il n’autorise que l’harmonisation vers le bas par le jeu du marché. Il faut donc oser dénoncer ce traité et l’action de la Commission européenne, comme des obstacles essentiels à tout projet de souveraineté économique, d’autonomie alimentaire et d’amélioration du sort des classes populaires, en France comme dans n’importe quel autre pays du continent. Ce n’est pas le seul obstacle, mais on ne peut pas arrêter le sacrifice des paysans, la croissance des pesticides, le recours à des technologies toujours plus onéreuses et destructrices (là où elles sont utilisées et là où elles sont fabriquées) tant qu’on respecte la liberté absolue de circulation des biens et de fixation de leur prix.
Si nous voulons arrêter le massacre, oui, nous devons rompre avec les interdits fondamentaux du débat politique (notamment à gauche) depuis l’époque Mitterrand : nous devons revendiquer et mettre en place des mesures protectionnistes, en assumant la réprobation que suscitera cette rupture à Berlin et à Bruxelles et le tollé que cela soulèvera dans les salles de rédaction des grands médias parisiens. Mais attention, protectionnisme ne rime pas forcément avec souverainisme (voir nos remarques en introduction à l’égard du mot d’ordre de souveraineté alimentaire), et peut même rimer avec internationalisme. La proposition qui a nos faveurs n’est pas le rétablissement de droits de douane sur les produits importés, mais la fixation, aux frontières de l’Hexagone, de prix minimum d’entrée. Elle est déjà portée par la Confédération paysanne depuis plusieurs années pour les fruits et légumes et pourrait être étendue à l’ensemble des productions agricoles.
On l’a mentionné plus haut, les effets de la concurrence organisée par la bureaucratie européenne sont particulièrement féroces pour les producteurs de fruits et légumes, qui ne bénéficient d’aucune subvention dans le cadre de la Pac. Le fond de la proposition de prix minimum d’accès au marché français, c’est qu’il ne peut coexister durablement dans le même espace commercial deux offres d’un même produit, équivalentes en qualité mais avec une différence de prix pouvant aller du simple au double. Tôt ou tard, l’une des deux offres disparaît et c’est précisément ce qui est en train d’arriver à des pans entiers de la production de fruits et légumes en France. S’ensuit, dans notre pays aussi, une spirale déflationniste en matière de salaires, de droits sociaux et de normes diverses et la recherche de nouvelles économies d’échelle par un surcroît d’industrialisation : c’est ce qui nous semble inacceptable. À défaut de pouvoir « imposer » immédiatement des salaires élevés et une bonne protection sociale partout en Europe, il faut donc trouver un moyen de neutraliser la compétitivité des importations, largement fondée sur une logique de dumping social et écologique : l’instauration de prix minimum d’accès au marché français. Ce prix devrait être fixé au niveau du coût de revient moyen, dans des conditions pédoclimatiques, sanitaires et sociales estimées de manière à la fois réaliste et exigeante, pour la France d’aujourd’hui.
Pourquoi serait-ce un meilleur moyen que la fixation de droits de douane ? Ceux-ci consistent en un impôt, parfois forfaitaire, mais le plus souvent proportionnel au prix de départ, que doit acquitter l’importateur. Ils peuvent protéger l’économie du pays qui les met en place, par le renchérissement de l’importation, mais ils n’ont pas d’effet positif dans le pays exportateur. Les producteurs étrangers peuvent limiter l’effet des droits de douane en diminuant encore leur prix de vente, donc leur coût de production – c’est précisément la dynamique contre laquelle nous nous battons. À l’inverse, les prix minimums d’accès n’enferment pas l’économie exportatrice dans la logique du dumping : non seulement les prix bas ne suffisent plus, alors, à gagner les parts de marché à l’export, mais les producteurs sont incités à déplacer la « compétition » sur d’autres variables que le prix. Le prix fixé aux frontières du pays importateur rend possible, dans le pays exportateur, des coûts de production plus élevés, donc de meilleurs salaires et rémunérations pour les exploitants, des méthodes moins nuisibles écologiquement, des efforts sur la « qualité » des produits. Le prix minimum d’entrée (par exemple, en France) rend tout cela possible, sans y obliger : c’est un dispositif qui respecte l’autonomie des autres pays, et surtout de leurs mouvements sociaux, qui peuvent plus facilement se mettre en lutte pour arrêter, chez eux aussi, la course au moins-disant social et écologique. Cette mesure leur donnerait du grain à moudre, y compris la possibilité de réclamer à leur tour un prix minimum d’entrée à leurs frontières. Elle est cohérente avec l’esprit de lutte internationaliste – permettre l’émancipation des travailleurs partout – qui devrait être celui de tout syndicat. Elle rend l’avancée vers une agriculture paysanne envisageable, parce qu’elle n’est plus forcément synonyme de perte de compétitivité.
Il arrive que des dynamiques d’harmonisation par le haut s’imposent. C’est ce qui s’est produit, de manière relativement inattendue, en 2015 quand la France a interdit unilatéralement l’usage du diméthoate : la Confédération paysanne avait obtenu l’activation par le gouvernement d’une disposition marginale du droit européen, qui l’autorisait à fermer les frontières de l’Hexagone aux importations de cerises traitées avec ce pesticide dans d’autres pays européens. La presse et les économistes néolibéraux promettaient une guerre commerciale en réponse à cette mesure de salut public. Or, la quasi-totalité des pays producteurs de cerises ont à leur tour interdit le diméthoate sur leur territoire pour que leurs producteurs gardent l’accès au marché français. Ainsi les initiatives unilatérales sensées peuvent-elles ne pas passer pour des agressions commerciales ! Au mouvement pour l’agriculture paysanne de faire connaître les prix minimums d’entrée dans un pays, comme une invitation faite à tous les autres de les adopter.
Nous ne disons pas que cela sera simple. Cette proposition contrevient frontalement aux principes du libre-échange gravés dans le TFUE. Et comme une modification de celui-ci nécessite l’accord des 27 États de l’Union (qui n’aura pas lieu), elle ne peut être mise en place qu’en désobéissant au traité et à la Commission. Il se trouve que plusieurs pays ou groupes de pays contreviennent actuellement à des règles, y compris centrales, du traité (l’accord de Schengen, le Pacte de stabilité et sa règle des déficits publics à moins de 3 % du PIB, la limitation des excédents agricoles…), sans provoquer de réaction sévère de la Commission. Nous sommes probablement entrés dans une ère de flottement, voire d’instabilité, où des marges de manœuvre inespérées peuvent surgir. À condition bien sûr qu’un rapport de force politique soit construit pour les imposer.
Par ailleurs, il est important de signaler que le règne de la concurrence et la course aux bas coûts de production ne sont pas seulement imposés par les traités de libre-échange, contre lesquels il faut faire mouvement. Ils sont aussi entretenus par notre habitus de consommateur accoutumé à pouvoir choisir sur des étals entre une multitude de produits venant de destinations variées et souvent lointaines. L’hypermarché est bien sûr le symbole de ce choix presque infini, qu’on retrouve aussi dans de nombreuses « biocoops », où la quantité de produits venant d’autres pays d’Europe ou d’autres continents est considérable et dans des réseaux locaux d’approvisionnement par Internet. On y consomme local, mais ça n’empêche pas du tout de snober la maraîchère ou le boulanger de son village qui n’est pas « en ligne », de les mettre en concurrence avec d’autres qui sont à 10 ou 20 kilomètres. Cette manière de s’approvisionner ne repose pas forcément sur la création de rapports personnels approfondis avec les producteurs du coin ni sur un engagement auprès d’eux.
L’engagement que nous avons en tête n’est pas celui que prônent Leclerc et autres chantres de la « consomm’action » labellisée. D’abord, ce n’est pas un engagement individuel, c’est un engagement collectif, qui sortirait d’une délibération à la fois économique et politique, une assemblée d’habitants qui s’occupent ensemble de leur approvisionnement, contre le vote du portefeuille et du paiement en ligne. Une telle démarche de relocalisation de la décision alimentaire aboutira probablement à une forme de relocalisation de l’alimentation. Mais l’autolimitation de notre liberté de consommer devrait être moins tournée vers la privation de produits lointains et exotiques que vers le renoncement à bénéficier à tout moment de la mise en concurrence des producteurs, qu’ils soient voisins ou pas.





